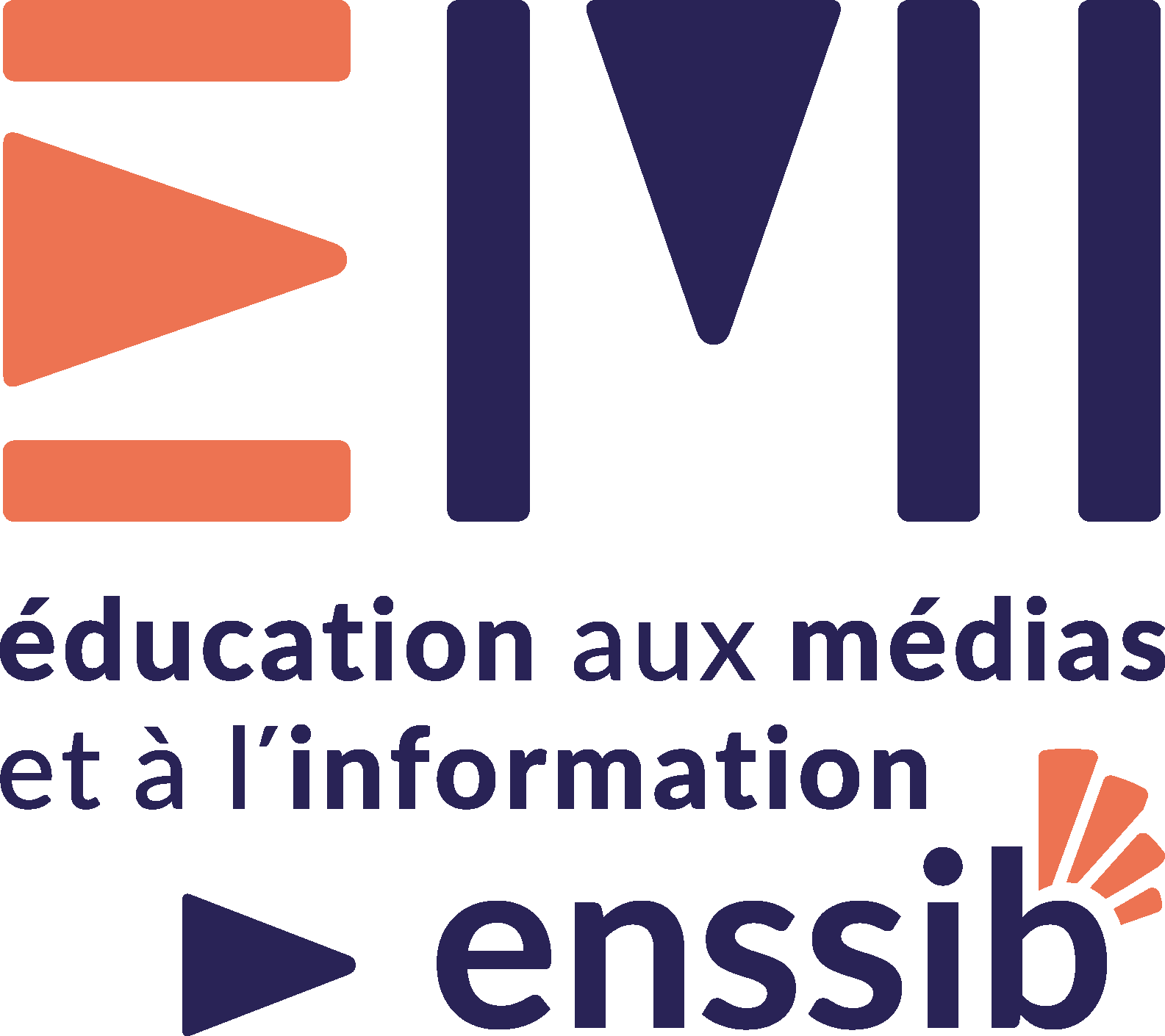- Pouvez-vous nous préciser brièvement pour quelle raison l’EMI en France est souvent abordée de façon partenariale ?
L’EMI est abordée de manière partenariale pour plusieurs raisons. La principale me semble être que l’EMI demande des compétences et des savoir-faire qu’un seul individu possède rarement. Si je prends l’exemple des projets dédiés à la thématique d’information d’actualité, il faudrait en effet que la personne en charge d’une activité d’EMI sur ce sujet soit capable d’apprendre aux participants à identifier des informations fiables, à écrire des articles de presse, à fabriquer des reportages audiovisuels, pourquoi pas puisse animer un débat sur des questions de société, transmette des connaissances sur le fonctionnement du monde journalistique… Le tout en mobilisant la pédagogie adaptée : ça n’est pas simple ! ça l’est beaucoup plus lorsque des acteurs et actrices de l’EMi issus d’univers professionnels différents mettent en commun leurs compétences et savoir-faire, par exemple lorsque des enseignants travaillent avec des journalistes.
- Vous citez les travaux d’Ysé Vauchez, sur les paniques morales et la structuration des fake news comme problème public. En quoi ces travaux sont-ils éclairants pour aborder la façon dont se structure l’EMI ?
Les travaux d’Ysé Vauchez, me semblent particulièrement pertinents car ils permettent de comprendre comment le thème des « fake news » a été construit comme problème public, spécialement dans le débat médiatique (télé et radio) et la manière dont cette construction joue, en retour, sur les dispositifs de « lutte contre les fake news » déployés dans différents contextes éducatifs. A ce titre, son article « La crédulité des crédules. Débat public et panique morale autour des fake news en France », paru dans la revue Emulations, en 2022, est particulièrement éclairant. A travers l’analyse d’un corpus d’émissions audiovisuelles qui portent sur ce phénomène en France entre 2017 et 2019, Ysé Vauchez montre bien comment les discours médiatiques élaborent petit à petit un cadrage univoque et anxiogène de la question des « fake news ».
- Vos enquêtes montrent que la question de l’illégitimité est toujours présente quand on parle d’EMI. Quelles en sont les raisons et comment les acteurs sur le terrain dépassent-ils ce sentiment ?
Les acteurs et actrices de l’EMI se sentent illégitimes car aucun d’entre eux ne peut prétendre à être « le » spécialiste de l’EMI. Si dans l’EMI chacun semble chercher sa place, et sans doute cherche à faire reconnaître sa part de légitimité à incarner une facette de l’EMI, aucun groupe professionnel ne se présente comme le seul à être légitime à « faire de l’EMI » : ni les journalistes, ni les enseignants, ni les enseignants documentalistes, ni les professionnels des bibliothèques, etc. Il y a sans doute plusieurs manières de faire face à cette question de l’illégitimité. La première consiste à développer ses compétences et ses savoir-faire dans le domaine de l’EMI, pour pallier ce sentiment d’illégitimité. Depuis quelques années on voit d’ailleurs se développer de nombreuses et diverses offres de formation dans le domaine de l’EMI, des formations universitaires, des formations professionnelles certifiantes, etc. Cette évolution ne se fait pas sans tension. Les plus visibles sont sans doute celles liées à des enjeux financiers ; les formations sont aussi des sources de revenus. Mais se rejoue aussi à ce niveau la question de la légitimité : qui est « légitime » à proposer des formations en EMI ?
La seconde manière de faire est peut-être de ne pas se présenter comme un spécialiste généraliste de l’EMI, mais de préciser son champ de compétence. Cela suppose d’ailleurs souvent des débats sur les termes à employer. Certains préfèrent ainsi dire qu’ils font de l’éducation à l’image, d’autres rappellent qu’ils proposent avant tout des « ateliers radios » comme le montrent Barbara Fontar et François Sorin dans leurs travaux. On observe des enseignants documentalistes qui concentrent leurs interventions sur des dimensions relatives à l’éducation à l’information, des journalistes qui interviennent spécifiquement sur tout ce qui touche à l’actualité, des artistes qui animent uniquement des ateliers d’écriture, etc. Au final on peut considérer que toutes et tous « font de l’EMI », qu’ils apportent leur pierre à cette « éducation à » dont la particularité est d’être très large. C’est souvent dans cette perspective que naissent les collaborations que vous évoquiez dans votre première question. Collaborer est aussi une manière de dépasser le sentiment d’illégitimité qui traverse les acteurs et actrices de l’EMI.