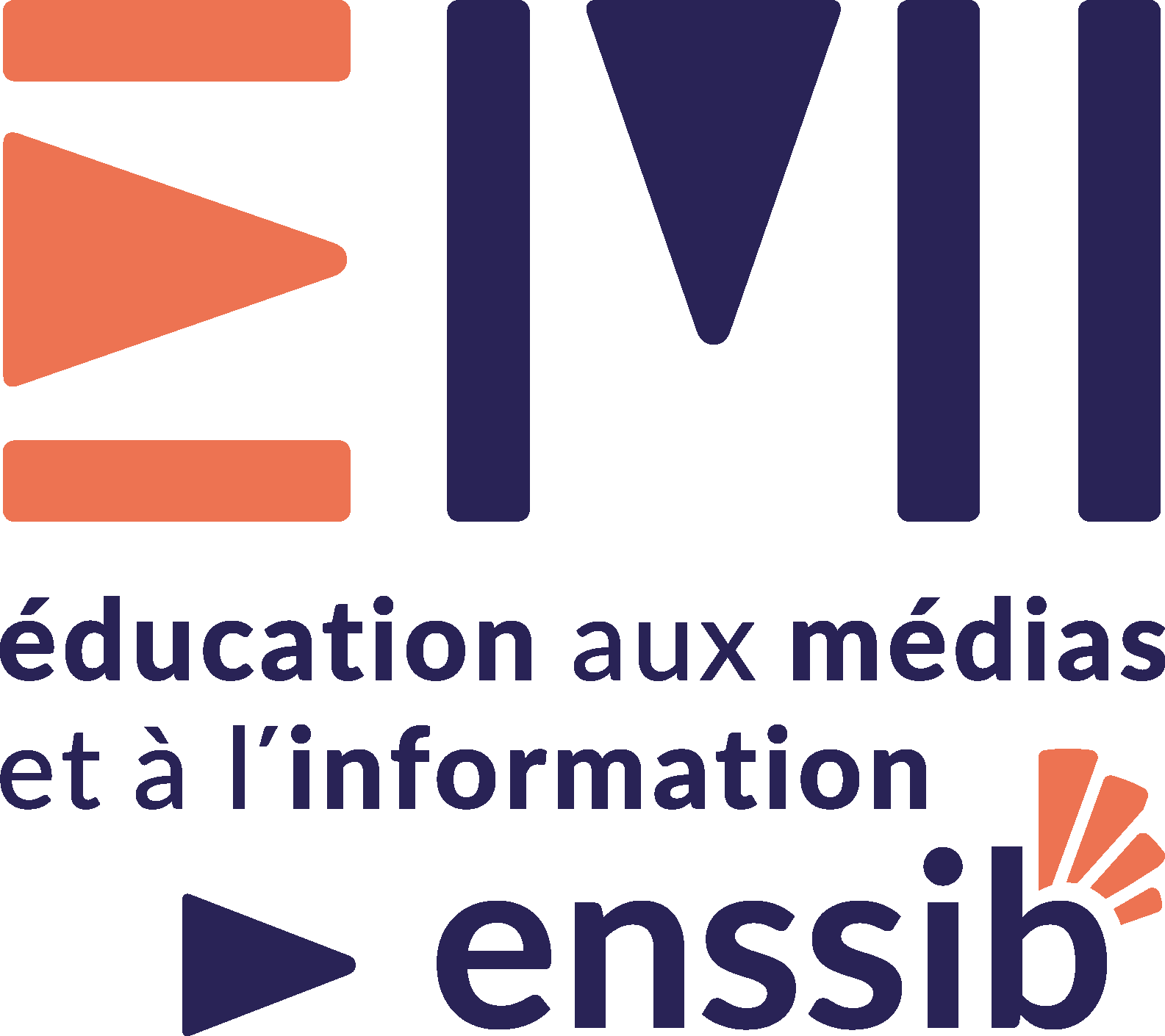1 – Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à l’éducation aux médias et à l’information ?
Je m’intéresse depuis longtemps à cette question puisque suite à mes études de philosophie, j’ai obtenu le Capes de documentation. J’ai donc été enseignante documentaliste, essentiellement au collège, pendant une quinzaine d’années ainsi que formatrice en charge de la formation continue de mes collègues. C’est donc une question qui m’a toujours beaucoup intéressée. Je l’ai d’abord embrassée en tant qu’enseignante « de terrain » et je la traite aujourd’hui en tant que chercheure, mais ces deux points de vue demeurent intrinsèquement liés et complémentaires à mes yeux.
2 – En quoi les pratiques numériques juvéniles sont-elles différentes de celles des adultes ?
Je ne suis pas sûre que les pratiques numériques des jeunes soient radicalement différentes de celles des adultes. En premier lieu, les jeunes deviennent des adultes et leurs pratiques sont précisément à prendre en compte dans le temps long et dans le continuum de la vie en général. Notamment en termes de citoyenneté : on ne devient pas adulte ni citoyen du jour au lendemain, ni en faisant table rase de ce qui précède cet âge. Certes, les usages des technologies par les jeunes sont souvent précurseurs des usages sociaux en général, et ce en particulier depuis les années 50. Mais je pense qu’il faut être très prudent quant aux enjeux commerciaux de cette spécificité attribuée aux pratiques numériques des jeunes. Il s’agit souvent d’un argument de vente et de la délimitation d’un cœur de cible marketing. L’autre point qui me fait prendre du recul par rapport à cette possible spécificité juvénile des pratiques numériques est l’hétérogénéité de ces pratiques, en termes de genre, d’origine sociale, de réussite scolaire, etc. Ce point me permet de souligner en revanche la spécificité des questions que posent ces pratiques numériques des jeunes : les enjeux de formation et d’accompagnement nécessaires des jeunes dans la construction de leurs usages au fur et à mesure de leurs expériences et de leur avancée en âge.
3 - Comment qualifieriez-vous le regard porté par les adultes sur les pratiques numériques des adolescents ?
Je ne suis pas certaine que l’on puisse parler du regard des adultes en général sur les pratiques des jeunes. Il me semble que le regard porté sur les pratiques numériques des jeunes dépend en premier lieu précisément de qui le porte, de ses objectifs et de son histoire individuelle : un enseignant, un parent, un soignant, un concepteur, etc. Je peux répondre en partie à cette question pour ce qui concerne les enseignants car c’est eux que je connais le mieux. A ce titre, je pense qu’il est très important que soient proposés des points de passage ou de partage, entre les apports des recherches scientifiques sur le sujet et les expériences pédagogiques menées par les enseignants. C’est précisément d’ailleurs l’intérêt de la journée d’étude que vous proposez.
4 – En quoi l’éducation aux médias et à l’information peut-elle aider au dialogue entre adultes et adolescents et faire évoluer les perceptions réciproques sur les pratiques numériques ?
Cette question me semble absolument primordiale pour l’éducation aux médias et à l’information, au-delà des compétences opérationnelles qu’elle promeut. Il s’agit en premier lieu de prendre en compte, et donc de connaître, la réalité des pratiques numériques des jeunes. Cela passe par la déconstruction des stéréotypes générationnels ou de genre à laquelle travaille la recherche. Ce premier point décrit finalement la formation des enseignants eux-mêmes et fait référence à ce que j’ai pu dire juste avant.
Le deuxième point est relatif à la dimension réflexive que peut revêtir l’éducation aux médias et à l’information : la réflexion du jeune (ou de l’adulte d’ailleurs) sur ses propres pratiques et sur les objets techniques qu’elles mobilisent. Il s’agit de prendre ces objets techniques (plateformes de réseaux sociaux, messageries de jeux vidéo, moteurs de recherche pour prendre quelques exemples) comme des objets d’apprentissage en tant que tels : à quoi ça sert ? comment ça marche ? pourquoi l’utilise-t-on ? etc. et pas seulement de les enseigner ou même de les utiliser dans le cadre de projets pédagogiques. Il s’agit également d’en faire quelque chose, de produire de l’information à son tour et de se questionner sur la nature et la forme de l’information que ces services et leurs fonctionnalités nous autorisent à produire. Afin de dépasser la peur des outils que l’on ne connaît pas ou que l’on ne connaît pas bien, que l’on n’utilise pas soi-même (ce dont certains enseignants témoignent), ces expériences pédagogiques doivent être conçues en partie avec les élèves. J’illustrerai ce point en citant l’exemple des « wiki concours ».
Propos recueillis par Véronique Branchut-Gendron & Julia Morineau-Éboli
Le 22 février 2021